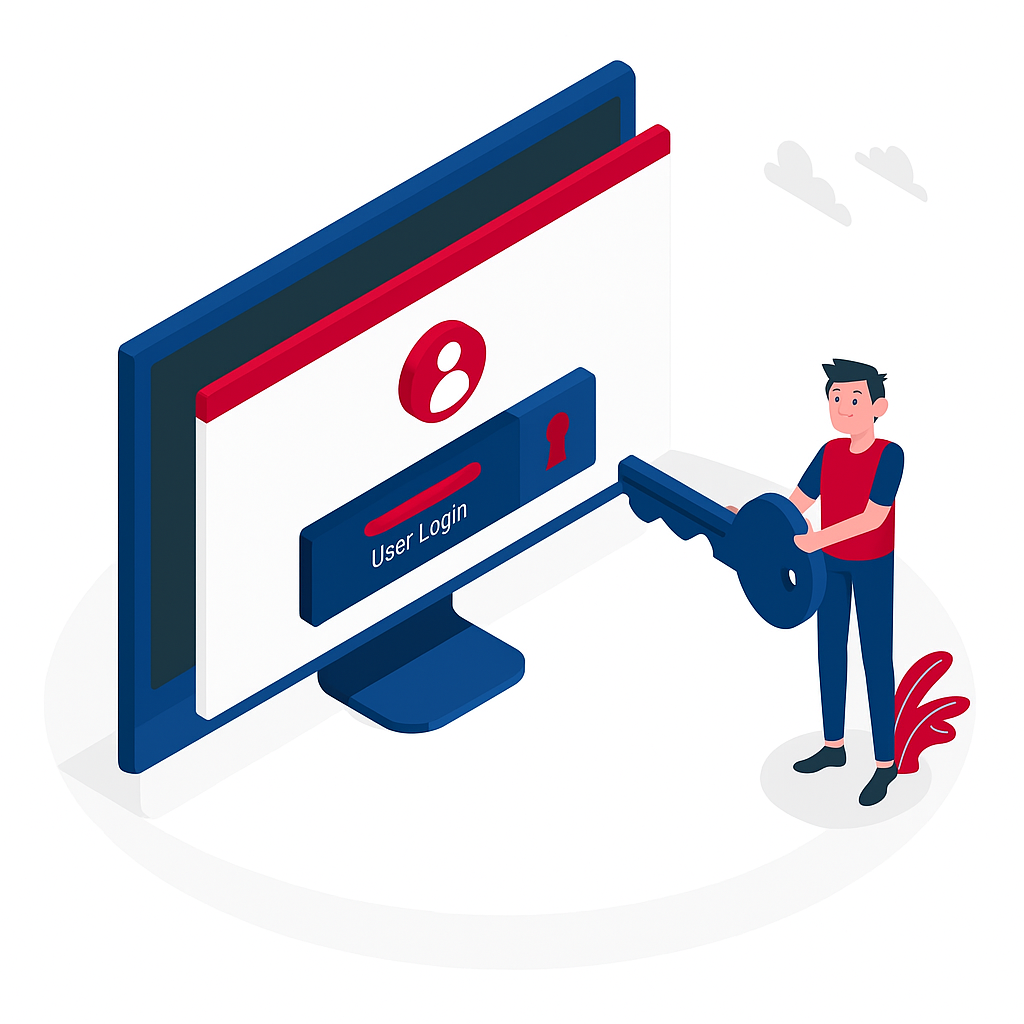LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ
La Cour constitutionnelle sud-africaine a tranché : interdire aux hommes de prendre le nom de leur épouse est discriminatoire. Derrière cette décision, rendue le 11 septembre 2025, se joue bien plus qu’une simple question administrative. C’est une remise en cause frontale des normes patriarcales qui structurent encore, en profondeur, l’institution du mariage.
Un héritage patriarcal mis à nu
La loi de 1992 sur l’état civil, qui encadrait jusque-là le changement de nom après mariage, reflétait une conception univoque : c’est à la femme d’abandonner son identité au profit de celle de son mari. En consacrant cette asymétrie, le législateur imposait aux couples un modèle familial où l’homme incarne la continuité et la femme l’adaptation.
Pour la Cour, ce déséquilibre n’était pas seulement une inégalité de traitement. Il constituait une atteinte directe à la dignité des femmes, en limitant la manière dont elles peuvent exprimer leur identité. Autrement dit, l’interdiction faite aux hommes d’adopter le nom de leur épouse n’était pas une simple formalité : elle renforçait un récit social où l’homme est le référent et la femme, l’exception.
Le poids de la mémoire et de la filiation
Les deux couples à l’origine du recours illustrent parfaitement cette tension. L’un souhaitait honorer la mémoire de parents disparus, l’autre préserver le lien symbolique avec une lignée familiale menacée d’extinction. Dans les deux cas, l’impossibilité juridique est venue heurter une aspiration intime : donner sens au nom comme vecteur de mémoire, d’héritage et d’égalité.
Le nom n’est pas qu’un identifiant administratif. Il cristallise une histoire, une appartenance, une filiation. En refusant aux hommes la possibilité d’endosser celui de leur épouse, l’État imposait une hiérarchie des filiations — masculine par défaut, féminine par tolérance.
Une victoire juridique… et une bataille politique à venir
Si la décision de la Cour est saluée comme une avancée, elle ne produit pas d’effet immédiat. Le Parlement a deux ans pour réécrire la loi. Ce délai souligne la lenteur des mutations sociales : reconnaître l’égalité en droit ne signifie pas qu’elle s’ancrera sans résistance dans les pratiques.
En Afrique du Sud, où les débats sur la violence de genre, l’égalité au travail et le droit de la famille restent brûlants, cette affaire révèle un point central : l’égalité se joue aussi dans les détails du quotidien, parfois invisibles, où les structures patriarcales s’expriment avec force.
Plus qu’un nom, une révolution symbolique
À première vue, permettre aux hommes de prendre le nom de leur épouse pourrait sembler anecdotique. En réalité, c’est une révolution symbolique. Elle consacre le droit de chaque couple à choisir son identité commune sans subir l’empreinte des hiérarchies de genre.
Derrière ce jugement, c’est une conception plus égalitaire du mariage qui s’impose : une union où les choix de nom, d’héritage et d’identité ne sont plus dictés par la tradition patriarcale, mais par la volonté des conjoints eux-mêmes.

Par Cheick Sékou BERTHE