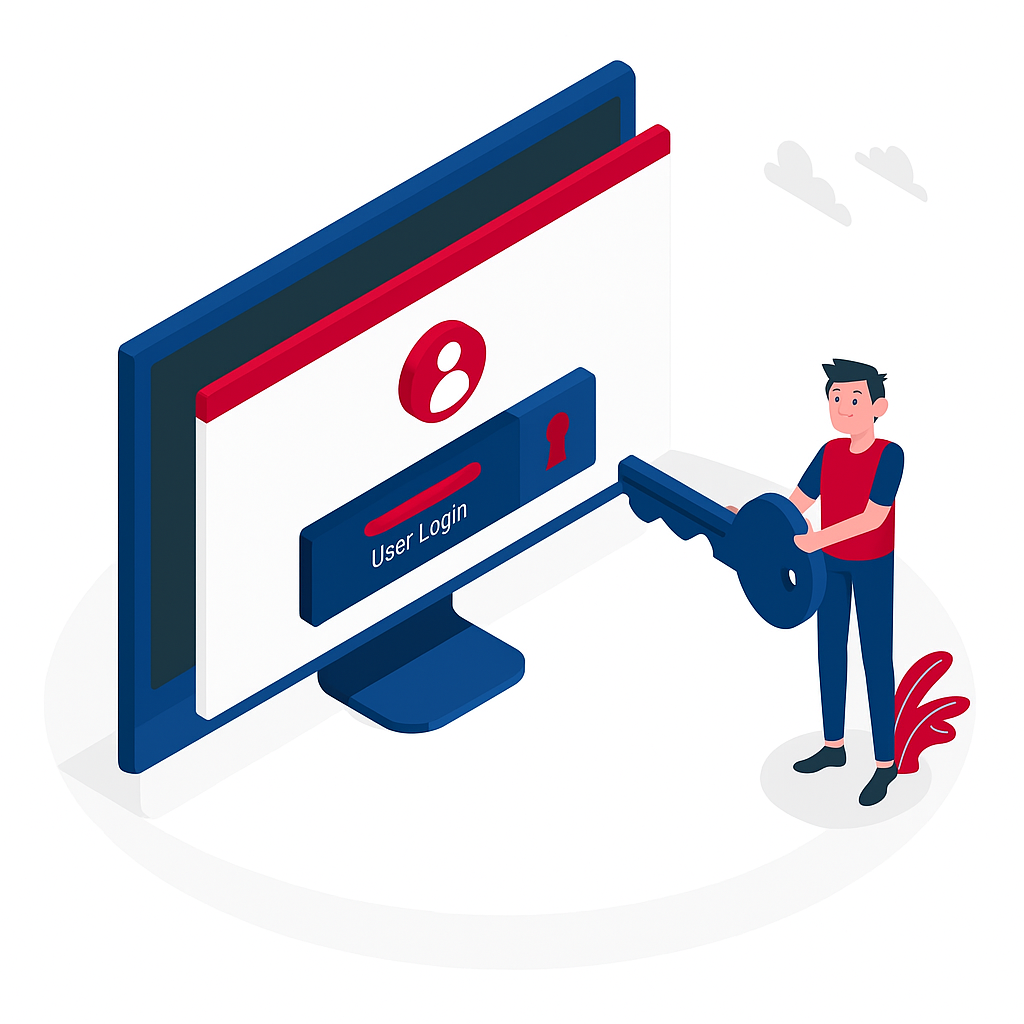Alors que nous peinons à acheter et valoriser nos produits agricoles dans les villages proches des frontières, ce sont nos pays voisins qui en tirent pleinement profit. Conséquence Leur PIB agricole augmente, pendant que le nôtre est au rouge.
Depuis plusieurs années, les gouvernements successifs ont certes encouragé la production locale, mais sans véritable accompagnement. Les agriculteurs qui ont cru en la terre ont consenti d’énormes efforts économiques et physiques pour cultiver des hectares de champs d’orange, de papaye, de mangue, d’anacarde, etc., souvent sans assistance technique ni accès sécurisé aux marchés.
Prenons l’exemple de la sous-préfecture de Niantanina : durant la période des récoltes, un seul agriculteur peut charger plusieurs remorques d’oranges ou d’anacardes pour les vendre, non pas à Kankan ou Conakry, mais au Mali.Pourquoi cela ? Parce que les localités frontalières manquent cruellement d’infrastructures routières menant vers les grands centres urbains guinéens.
Le transport des produits devient donc coûteux, risqué et presque impossible, poussant les producteurs à se tourner vers les pays voisins, mieux accessibles.Pire encore, aucun appui structuré de l’État n’est apporté à ces agriculteurs. Même pour l’engrais, ils doivent parcourir plusieurs kilomètres sur des routes dégradées pour espérer en obtenir dans les préfectures. Pendant ce temps, les discours officiels se répètent, sans traduction concrète sur le terrain.
Les marchés guinéens semblent saturés, ce qui freine la demande en produits locaux. La faiblesse du pouvoir d’achat, combinée à la forte présence de produits importés, y contribue grandement. Par exemple, le riz cultivé localement est moins présent sur nos marchés que celui importé, malgré le potentiel de production nationale.
Et pourtant, le slogan « Produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons » continue de raisonner dans nos oreilles sans réel impact sur la politique agricole nationale. La majorité des industries de transformation alimentaire implantées au Mali par exemple sont approvisionnées en matières premières par nos agriculteurs locaux, preuve que la production existe mais pas bénéfique pour nos pays tout simplement parce qu’il y a un manque de structuration, de valorisation et d’accès au marché intérieur.

Un exemple marquant : un grand agriculteur de Niantanina, avec plus de 45 hectares d’arbres fruitiers, n’a reçu aucun acheteur guinéen cette année. Résultat, les produits cultivés en Guinée deviennent, après vente au Mali, des produits « made in Mali ». Une réalité triste et révoltante.Dans la mise en œuvre des projets agricoles et industriels, les cultures comme l’anacarde, la papaye ou les agrumes sont souvent prises en compte à de très faibles proportions, malgré leur potentiel commercial.
Il est urgent que le ministère de l’Agriculture revoie sa politique de valorisation des filières agricoles et la marque , avec notamment :
– une meilleure cartographie des producteurs par filière,
– une stratégie nationale de mise en marché local des produits agricoles,
– un meilleur accès aux infrastructures de stockage, transport et transformation.
– et surtout envisager la création d’unités industrielles et transformation ou de conservation dans ses zones frontalières à grande potentialité agricole.
Ce n’est pas un duel commercial qui est recherché entre les États et les producteurs, mais plutôt un duo stratégique, capable de valoriser nos ressources agricoles pour le bénéfice de tous. Sinon la perte est silencieuse pour notre économie .
Par Moussa TOURÉ