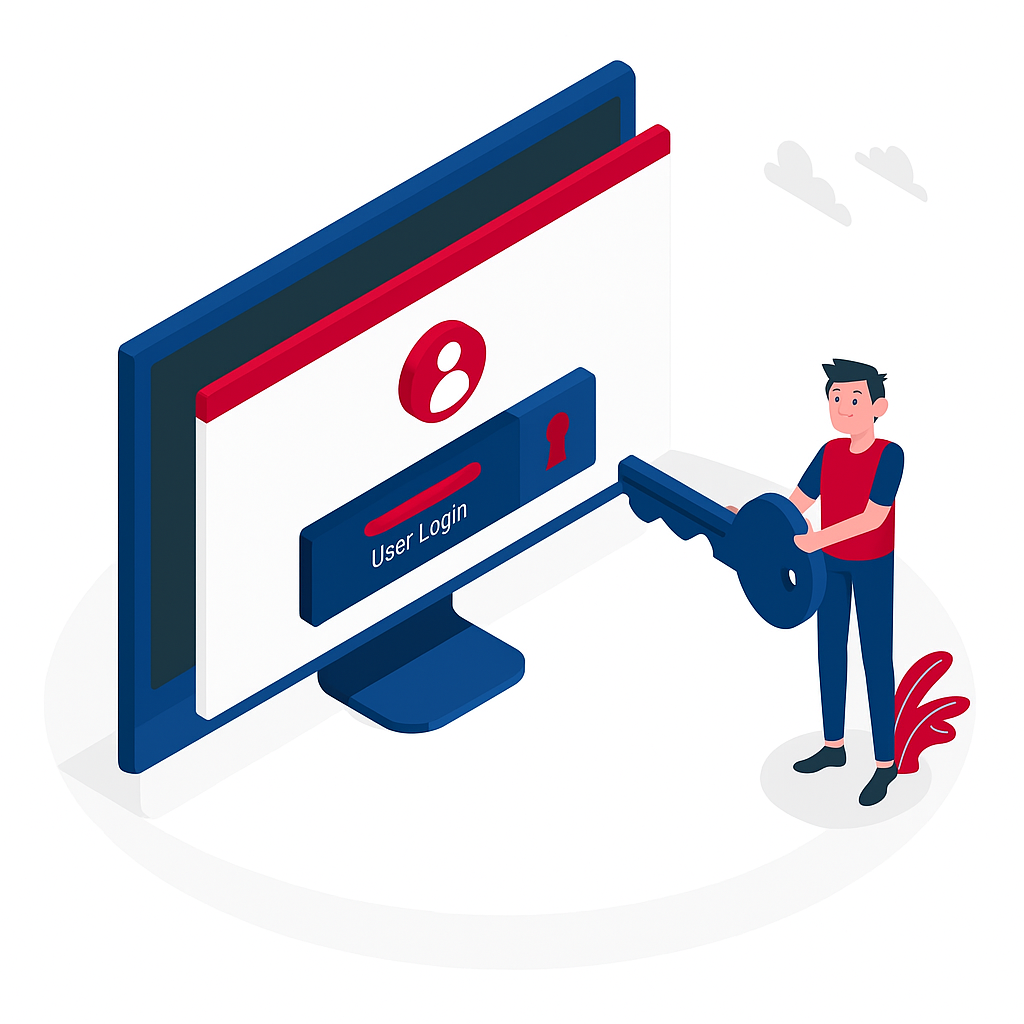« L’explosion démographique à l’origine de l’occupation anarchique des sols »
Historiquement, la ville de Conakry a connu une poussée démographique sans précédent. L’exode rural, combiné à une croissance naturelle élevée, a entraîné une augmentation constante de la population vers la capitale, en quête de meilleures conditions de vie.
Il est objectivement observable que cette croissance n’a pas été accompagnée d’une politique d’aménagement adaptée, ni d’un plan d’urbanisation fonctionnel. Cela a engendré une pression foncière intense, aggravée par l’inaccessibilité du logement formel pour les couches les plus démunies. Ainsi, de nombreuses familles se sont rabattues sur des espaces inappropriés à l’habitation : bas-fonds, zones marécageuses ou encore canaux naturels de ruissellement. Ces zones, non seulement exposées aux inondations, sont également souvent dépourvues d’infrastructures de base telles que l’assainissement et l’évacuation des eaux pluviales.
Dans les analyses sur les inondations de 2025 à Conakry, une réalité sociale et juridique est trop souvent ignorée : en Guinée, la famille élargie résidait fréquemment dans une seule maison, parfois avec quelques plantations héritées du défunt chef de famille. Avec l’augmentation du nombre de membres issus de différentes lignées et générations, cette maison et ces domaines agricoles devenaient rapidement invivables.
Dans un contexte de pauvreté, l’indivision successorale est devenue une véritable source de tensions. L’urgence de trouver un toit personnel poussait les héritiers à exiger le partage de la masse successorale, soit à l’amiable, soit par voie judiciaire. Ce partage, bien que nécessaire pour apaiser les conflits internes, obligeait chaque héritier à chercher un terrain abordable pour construire. Faute de moyens, ces derniers n’avaient souvent accès qu’à des parcelles situées dans des zones à haut risque, hors des plans d’urbanisation, et sans la moindre étude géotechnique préalable.
De plus, le coût des services d’un ingénieur ou d’un architecte étant prohibitif, les constructions se faisaient de manière spontanée, souvent en dehors de toute réglementation. Ce phénomène, massif mais discret, alimentait une urbanisation sauvage, structurellement vulnérable aux catastrophes naturelles.
Les habitations sont ainsi édifiées sans l’assistance de corps de métier qualifiés (architectes, ingénieurs, géomètres), dans des conditions précaires, sur des sites instables ou inondables. Cela fragilise non seulement les bâtiments, mais expose également leurs occupants à un danger permanent.
L’année 2025 a tristement confirmé ces inquiétudes : les fortes précipitations ont entraîné des inondations majeures, causant des morts par noyade, la destruction de logements entiers, et l’exode temporaire ou définitif de centaines de familles. (Paix aux âmes des disparus.)
L’État est censé réguler l’occupation des sols et protéger les citoyens. S’il peine à jouer pleinement ce rôle, se poursuivront les occupations anarchiques en violation de la réglementation foncière en vigueur. Dans ce contexte, les autorisations de construire sont soit inexistantes, soit obtenues dans des conditions opaques. Les zones à risques ne sont ni suffisamment délimitées ni protégées. Ce laxisme administratif favorise l’émergence de quartiers construits dans l’illégalité et la précarité.
C’est pourquoi il devient urgent de renforcer la planification urbaine, notamment par une cartographie claire des zones à risques et des espaces constructibles.
L’ingénierie préventive s’impose comme la voie durable à cette problématique, en rendant obligatoire l’étude géotechnique pour toute nouvelle construction dans les zones à occuper, compte tenu des réalités climatiques du pays.

Moussa KANDE, Philosophe et juriste, consultant juridique et Enseignant chercheur.
Tel: 620840010
Email: kandemoussa1@gmail.com